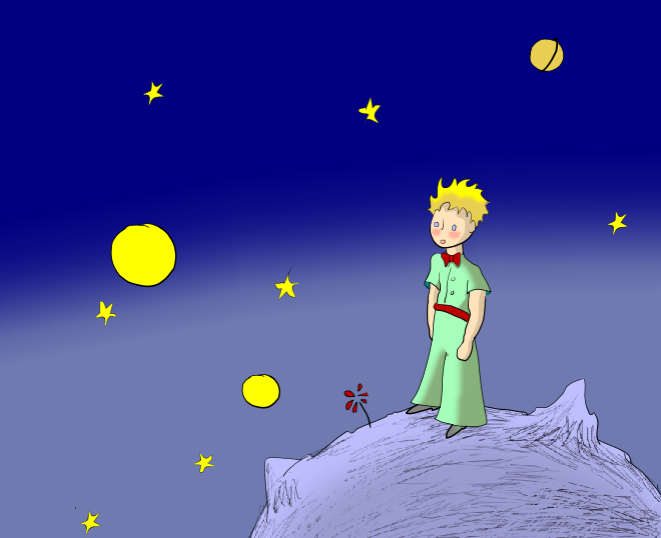Gilles Deleuze (DR)
«
Un
cours c’est quelque chose qui se prépare énormément. Si vous voulez
cinq minutes, dix minutes d’inspiration, il faut préparer beaucoup,
beaucoup, beaucoup », affirme Deleuze dans
l’Abécédaire. La préparation des cours chez Deleuze est souvent rapprochée d’une série de pratiques artistiques : «
Un cours ça se répète. C’est comme au théâtre… c’est comme dans les chansonnettes, y a des répétitions ».
De prime abord, de telles comparaisons ont quelque chose de convenu
pour quelqu’un qui, formé dans les khâgnes et à la Sorbonne de l’après
1945, a connu comme élève et étudiant les «
exhibitions souvent théâtralisées de l’improvisation philosophique » décrites par Bourdieu dans ses
Méditations pascaliennes.
On remarquera cependant que ces rapprochements avec les arts concernent
davantage la préparation des cours que leur exécution proprement dite.
Il n’existe pas chez Deleuze de justification philosophique de
l’exécution théâtrale ou musicale de l’enseignement de la philosophie.
La pédagogie deleuzienne ne reproduit pas davantage l’éloge fiévreux de
la rencontre avec le professeur de philosophie comme maître à penser
inspiré
[1].
A
travers la comparaison avec les arts, c’est d’abord d’un véritable
dressage qu’il est question, d’où une série d’expressions éminemment
suggestives : «
Y a pas d’autres mots que ‘se mettre dans la tête’
(…). Or ça va pas du tout de soi trouver intéressant ou passionnant ce
qu’on dit (…). Il faut trouver la matière que l’on traite, la matière
que l’on brasse, il faut la trouver passionnante (…). Or, il faut
parfois se donner de véritables coups de fouet (…). Il faut se monter
soi même jusqu’au point où l’on est capable de parler de quelque chose
avec enthousiasme. C’est ça la répétition ». Les termes propres à
qualifier ce travail de préparation sont d’un côté au plus loin de ceux
qu’engagent un rapport à la culture fait de distance et de désinvolture
propre aux « détenteurs de naissance ». Mais la présentation de ce
travail acharné n’est pas pour autant identique à la valorisation d’une
acquisition et d’une thésaurisation laborieuses des connaissances que
l’enquête sociologique décèle dans le discours des autodidactes et des
membres de la petite bourgeoisie. Trouver sa matière passionnante,
intéressante, être « habité » par elle, « se monter » au point de parler
avec enthousiasme : comment mieux dire que la croyance (en ce qu’on
enseigne) ne va pas de soi, et que, comme le laissent entendre les
comparaisons avec la musique et le théâtre, elle suppose, davantage
qu’une besogne, une véritable ascèse apte à dresser et à transfigurer un
individu ?
Les arts constituent sans doute chez Deleuze un véritable paradigme
de l’apprentissage. Ce n’est pas un hasard si c’est dans un livre
consacré à un écrivain (
Proust et les signes) que le philosophe y a justement exposé son idée de l’apprentissage : «
On
ne sait jamais comment quelqu’un apprend ; mais, de quelque manière
qu’il apprenne, c’est toujours par l’intermédiaire de signes, en perdant
son temps, et non par l’assimilation de contenus objectifs. Qui sait
comment un écolier devient tout d’un coup ‘bon en latin’, quels signes
(au besoin amoureux ou même inavouables) lui ont servi d’apprentissage ?
Nous n’apprenons jamais dans les dictionnaires que nos maîtres ou nos
parents nous prêtent ». Des interprétations silencieuses de l’amour aux modes d’inculcation totaux et pratiques de l’art («
on
n’apprend jamais en faisant comme quelqu’un, mais en faisant avec
quelqu’un, qui n’a pas de rapport de ressemblance avec ce qu’on apprend »),
en passant par les cercles mondains, la relecture deleuzienne du
devenir artiste de Proust porte en lui un hommage à la part implicite de
tout apprentissage.
Cette pédagogie du silence qui convertit en signe de gloire les
stigmates de l’apprenti (détours, piétinements, lubies, découragements
et déceptions), engage également une critique des valeurs proprement
scolastiques de la discussion et de l’explicitation, de l’effort et de
la bonne volonté. De fait, l’institution scolaire avec ses rituels
d’intégration, ses maîtres, ses exercices, mais aussi sa sociabilité
étudiante, est bien la grande absente de ce livre sur l’apprentissage
dominé par le couple de l’art et de l’amour. Cette absence, ou mieux,
cette présence toute négative (on n’apprend pas avec les dictionnaires
de ses maîtres, il faut se méfier de l’amitié, fuir la discussion, etc.)
peut surprendre chez quelqu’un qui fut reconnu par l’institution
scolaire autant qu’il l’a reconnue, et qui dans quelques rares propos
autobiographiques donne parfois le sentiment de devoir son salut à une
réussite purement scolaire, notamment lorsqu’il évoque les propriétés
d’un univers familial (« famille bourgeoise », « inculte », père
antisémite, mère catholique) avec lesquelles il a eu le plus visiblement
besoin de marquer la distance.
Mais chez ce grand bourgeois parisien, le choix de l’artiste Proust
pour décrire le mouvement de l’apprentissage, est peut-être une manière
(bien involontaire) de faire la part à l’implicite de sa propre élection
scolaire et de son sens des ambitions légitimes. Aux cercles mondains
où Proust « perd » son temps, répondent (serait-on tenté de dire) ces
groupes à très forte concentration en capital culturel où Deleuze le
jeune (alors lycéen) a poursuivi, à l’extérieur de l’Ecole, sa
socialisation à l’univers de l’esprit : des « rencontres » organisées
par la médiéviste Marie-Magdeleine Davy du temps de l’occupation
allemande (où l’on chuchote autour de Deleuze : « Cela va être un
nouveau Sartre »), aux réunions chez Marcel Moré, dans son appartement
du quai de la Mégisserie, où Georges Bataille et Jean-Paul Sartre
débattent sur « Mal et péché »…
À voir Deleuze retrouver et ressusciter dans
Proust et les signes
un apprentissage silencieux et obscur, opposé aux valeurs scolastiques,
on ne peut s’empêcher de reconsidérer certaines anecdotes concernant
son propre parcours scolaire, anecdotes qui témoignent de ses rapports
problématiques avec les représentants de l’institution philosophique
sans doute engendrés par son
hubris de prétendant. Considérons le
témoignage que Jean Pierre Faye, camarade et ami de Deleuze en classe
préparatoire à Louis le Grand, a rapporté à François Dosse : «
Deleuze
assiste au lycée Henri-IV à quelques cours de Jean Beaufret qui est
alors l’introducteur en France de l’œuvre de Heidegger. Fasciné par son
maître, Jean Beaufret affirme à sa suite qu’on ne peut vraiment la
comprendre qu’en parlant et en pensant en allemand. La semaine suivante,
Deleuze vient le contredire et lui oppose une solution sarcastique en
disant avoir trouvé en Alfred Jarry le poète français qui non seulement a
compris mais annoncé Heidegger »
[2].
Devant cette scène de défi symbolique, il faudrait commencer par
poser des questions en apparence triviales : où était physiquement situé
Deleuze dans l’espace de la classe en venant proposer cette
« solution » ? Au premier rang, au fond, assis, debout ? Etait-il seul
ou « en groupe », c’est-à-dire accompagné par des amis, des admirateurs,
des « déjà convaincus » ? Qu’est-ce qui dans la suggestion du jeune
Deleuze a pu susciter le scandale pour Jean Beaufret, scandale qui ne
semble pas pouvoir se résumer à la situation d’extra-territorialité de
Deleuze dans ce cours où il n’est pas officiellement inscrit? Jarry
poète, avec sa littérature comique très sexualisée et ses « blagues
scato », ne peut-il habiter l’ontologie heideggérienne du
Dasein?
Surtout, le rapprochement Jarry-Heidegger ne libère-t-il pas tout un
inconscient scolaire ? Qu’on songe par exemple que la plus ancienne
version connue d’
Ubu roi de Jarry,
Les Polonais, met en
scène, pour le tourner en dérision, un professeur du lycée de Rennes (M.
Hebert, professeur de physique), source comique d’une littérature
scolaire abondante semble-t-il. Qu’on songe encore au rôle de
« précurseur » que Deleuze confère à Alfred Jarry par rapport à
Heidegger : comment Beaufret, ami, correspondant, introducteur, et
surtout commentateur « mandaté » du philosophe allemand en France,
pouvait-il recevoir cette proposition sans sentir, dans toute sa
violence, une contestation implicite de son propre statut et d’une
situation de quasi monopole d’accès à la lettre heideggérienne, à une
époque où les textes du philosophe allemand étaient pratiquement
inaccessibles faute de traduction ?
Il y a quelque chose de potache dans le geste de Deleuze, mais sous
la légèreté apparente, il faut voir la force de mise à nu scandaleuse
d’un tel procédé. Précisément parce qu’il apparaît trop visiblement
comme un « truc » d’étudiant destiné à contourner la voie d’accès royal
(la langue allemande dans cet exemple) à la lecture du texte sacré, il
témoigne sans doute d’un empressement suspect à parvenir. Mais du même
coup il trahit brutalement le secret des grands initiés en rendant
visible les modalités d’acquisition réelle de l’histoire de la
philosophie : soit la série des trucs, des tours, des coups de forces et
des artifices plus ou moins audacieux et périlleux, plus ou moins
avouables et explicitement transmissibles, mis en œuvre pour réaliser la
tâche de connaître une histoire (celle de la philosophie) dont
Canguilhem a pu dire « qu’on la sait ou qu’on ne la sait pas ».
Le geste de Deleuze trahit d’autant plus qu’il est sérieux, autrement
dit qu’il est le fait d’un vrai croyant cherchant réellement une
« solution » pratique à l’appropriation de la philosophie
heideggérienne. Bref, loin de constituer une entreprise de protestation
naïve, la revendication d’un tel mode d’accès détourné à la lettre
philosophique, opposé à un accès « droit » et « conforme », pourrait
bien exprimer des prétentions d’autant plus troublantes qu’élevées,
forcées peut-être, pour se faire admettre, d’emprunter une forme quasi
parodique. On dirait de ces prétentions qu’elles louchent, c’est-à-dire
qu’elles regardent simultanément vers la continuation ou la reproduction
du jeu qu’elles épousent et vers l’imposition d’une autre norme pour le
jeu, au point de « fausser » l’image même de ce sur quoi portent les
prétentions légitimes.
D’ailleurs, Deleuze n’aurait-il pas réalisé dans
Logique du sens
l’analyse de ces prétentions louches à l’occasion d’une relecture de
Platon, axée sur l’opposition de la copie et du simulacre, c’est-à-dire
sur l’opposition entre des prétendants «
bien fondés, garantis par la ressemblance », une ressemblance intérieure et intériorisée (les copies) et ceux qui prétendent «
par en dessous, à la faveur d’une agression, d’une insinuation, d’une subversion »
(les simulacres) ? L’interprétation de cet univers platonicien et de
son mythe du fondement qui hiérarchise les prétendants à l’essence entre
les copies, prétendants «
possesseurs en seconds », et les simulacres qui ne possèdent que la «
mauvaise puissance du faux prétendant »,
aurait bien des affinités avec une analyse de la participation et de la
conduite scolaires, ou des manières d’être au jeu scolaire.
A la limite, dans le cas de celui qui, comme Deleuze en 1969 avec
Logique du sens,
consomme une rupture (déjà largement entamée) avec ses maîtres
académiques, et affirme un peu plus une prétention de producteur venant
doubler un statut de reproducteur conquis sur la base d’une série de
livres d’histoire de la philosophie, ne pourrait-on comprendre comme une
forme de quasi auto-analyse de son propre parcours scolaire ce triomphe
des simulacres qui abolit symboliquement le statut malheureux de
copiste, dont la limite, en situation scolaire, se situe dans la
restitution « déformée » du discours professoral, à force bien souvent
d’une recherche d’ajustement aux attentes supposées du maître ?
Au centre expérimental de Vincennes, que Deleuze intègre au début de
l’année universitaire 1970-1971, haut lieu de la nouvelle vie étudiante
« antiautoritaire » et « antirépressive » de l’après Mai 1968, la
« révolte des simulacres » aura peut-être rencontré dans les
dispositions d’un public pratiquement dépourvu d’anciens élèves de
classes préparatoires et essentiellement composé d'étudiants inscrits
dans d'autres départements, les conditions d’un rendement optimal. A
Vincennes, le professeur de philosophie «
parle devant un public qui
comporte à des degrés divers des mathématiciens, des musiciens, de
formation classique ou de pop’ music, des psychologues, des historiens
(…). Un tel enseignement n’est nullement de culture générale, il est
pragmatique et expérimental, toujours hors de lui-même, précisément
parce que les auditeurs sont amenés à intervenir en fonction de leurs
besoins ou d’apports qui sont les leurs »
[3]. D’où aussi ce rapport à la culture ouvertement valorisé dans son enseignement vincennois : «
J’ai
toujours pensé qu’un cours ça impliquait une collaboration entre ceux
qui écoutent et celui qui parle – et que cette collaboration ça ne
passait pas forcément par la discussion, même ça passait très rarement
par la discussion. Les types à qui sert quelque chose qu’ils écoutent,
(…) ça leur sert six mois après, et à leur manière, dans un tout autre
contexte. Ils le prennent, ils le transforment et tout ça aussi, c’est
des merveilles »
[4].
Prendre, transformer, déplacer dans un « tout autre contexte » :
encore et toujours cette part silencieuse de l’apprentissage opposé aux
valeurs scolastiques de la « discussion » et à la transmission explicite
de règles ou de méthodes formalisées, s’y ajoutant le traitement
« artiste » de la matière professorale (détournements, transformations,
déplacements dans d’autres contextes pratiques) opposé à la restitution
par la copie. Cependant, les rapports de l’hérésiarque Deleuze à cette
« institution d’avant-garde », n’ont rien de simple ni de simplement
heureux.
En 1973, deux ans à peine après son arrivée au centre expérimental,
Deleuze exprime déjà une certaine lassitude devant une dimension bien
connue du folklore vincennois : «
(…) j’ai été soutenu, injurié,
interrompu, par des militants, des faux-fous, des vrais-fous, des
imbéciles, des types très intelligents, il y avait une certaine rigolade
vivante à Vincennes. Ca a duré deux ans, ça suffit, il faut bien
changer »
[5]. Mais dix années plus tard, à
Saint-Denis cette fois, dans un département qui opère une normalisation
de son cursus en cherchant à obtenir le droit à délivrer des diplômes
nationaux, quelque chose du « cirque » vincennois s’est bien conservé.
En témoigne cette confession du professeur Deleuze à son auditoire lors
de la première séance de l’année 1982-1983 : «
Quand je réfléchis à
mon destin des autres années – là je fais une espèce de confession
devant vous, vous me la pardonnez – je me dis : qu’est-ce que je fais
depuis dix ans ? Depuis dix ans je fais le clown ! je fais le clown et
vous le savez bien, c’est pour ça que vous venez très très nombreux. Je
ne dis pas que vous venez pour rigoler, non évidemment, si vous venez
c’est que ça vous intéresse, mais c’est du spectacle ». A la lumière
de cet extrait, le cirque et la clownerie désignent moins les
interventions débridées de la période héroïque vincennoise (faux frais
de l’avant-gardisme), que ce qui ramène Vincennes (devenu Saint-Denis)
et sa « pédagogie expérimentale » à la situation scolaire traditionnelle
du cours d’amphithéâtre, soit à un numéro de virtuose solitaire
[6].
C’est avec cette situation que le programme deleuzien pour l’année 1982-1983 doit permettre de rompre : «
Pendant
plus de dix ans j’ai fait des cours pour tout le monde, accordez moi
cette année d’en faire un qui ne soit pas pour tout le monde (…). Ce que
je demande, c’est la formation d’un petit groupe qui accepte à la fois
les conditions que je suis en train de proposer, revenir, ressasser et
perfectionner, perfectionner avec moi ce qu’on a fait ». Ce
programme de transformation du numéro de clown en un atelier de travail,
où l’auditoire est invité à venir reprendre et à corriger le
maître, serait à classer parmi les indices de ce renouvellement que le
Deleuze du début des années 1980 recherche en investissant la peinture
et le cinéma, après la décennie 1970 marquée par les folies de la
période vincennoise et du travail philosophique et politique avec
Guattari.
Formulé en termes de vie ou de mort («
mon projet auquel je tiens comme à ma vie, ma vie spirituelle »),
un tel programme suppose la volonté de se réapproprier certains outils
scolaires comme le tableau, en même temps qu’il touche, l’un après
l’autre, à une série d’éléments propres à la situation d’enseignement et
qu’il en trahit la solidarité : le rythme et l’allure du cours, le
nombre d’auditeurs, la possibilité pour l’auditoire d’être assis, de
pouvoir se déplacer (pour accéder au tableau notamment) et donc de
collaborer, jusqu’au problème de la compétence et de l’entente implicite
entre participants. Tant et si bien qu’au cours de cette mise en
question systématique, c’est à une croyance « paris-huitarde » que le
programme deleuzien achève de se heurter au moment même où il prétend se
mettre en règle avec elle : «
J’ai donc besoin d’un groupe
restreint. Alors vous me direz : les autres ? Moi je veux, cette année,
je ne l’ai jamais demandé les autres années, sauf pour rire, je l’ai
demandé mais je n’y croyais pas, cette année j’y crois. J’exclus, ça va
de soi, j’exclus de faire ce qu’on appelle un séminaire fermé – parce
que ça me paraît honteux, c’est le contraire de ce qu’est Paris 8 – ce
n’est pas ça ce que je veux »
[7]. Dans un
département en voie de normalisation, déplacé de force de Vincennes à
Saint-Denis avec l’ensemble de l’université expérimentale, le terrain
sur lequel se trouve Deleuze est risqué puisque son programme peut être
entendu comme une tentative d’imposition à peine voilée d’un
numerus clausus, autrement dit comme une forme d’attentat à la croyance locale (le séminaire « ouvert »).
Mais la discussion avec les étudiants qui s’en suit, au cours de
laquelle Deleuze réfrène à la fois l’assurance statutaire de ceux qui
sont prêts à organiser « l’auto-sélection » des participants, et où il
refuse d’abandonner purement et simplement à leur sentiment
d’illégitimité et d’incompétence ceux qui ne voient pas bien comment ils
pourraient travailler en « groupe restreint » avec le professeur
(ceux qui sont donc tentés par l’auto-élimination), illustre aussi cet
art étrange dans lequel Deleuze excelle, cet art qui nécessite un peu de
schizophrénie. De l’art de conserver la croyance et de l’invoquer dans
sa pureté tout en rendant possible l’interprétation de la croyance. De
l’art de rendre la croyance aux croyants et à la « libre » discussion
entre croyants tout en la mettant de son côté. De l’art de remettre la
croyance en jeu pour en rappeler la valeur, tout en se mettant soi-même
totalement en jeu, donc de faire sentir le prix et le coût d’une stricte
observance de la croyance. On n’en finirait pas d’énumérer les
paradoxes propres à un cas si exemplaire de « manipulation » de la
croyance, cas qu’il n’y a pas lieu, bien au contraire, d’interpréter
cyniquement. N’est-ce pas à travers le risque qu’il prend de heurter une
croyance auquel il doit une partie de son succès hérétique des années
1970 que se mesurent aussi les exigences de renouvellement de Gilles
Deleuze?
[1] Sébastien Charbonnier S.,
Deleuze pédagogue, l’Harmattan, 2009, page 32.
[2] François Dosse,
Gilles Deleuze et Félix Guattari, La Découverte
, 2009, page 121.
[3] Deleuze, « En quoi la philosophie peut servir à
des mathématiciens ou même à des musiciens – même et surtout quand elle
ne parle pas de musique ou de mathématiques », publié dans l’ouvrage
collectif :
Vincennes ou le désir d’apprendre, Editions Alain Moreau, 1979, p.120-121.
[4] Cours du 2 novembre 1982 (partie 1), « Cinéma :
une classification des signes du temps », en ligne sur « La voix de
Gilles Deleuze », Université Paris 8.
[5] Deleuze,
Pourparlers, Minuit, 1990, page 20.
[6] En outre, dans un département qui, en 1982-1983,
est à son niveau le plus bas en nombre d’inscrits depuis la période
1970-1975, il n’est peut-être pas absurde de supposer que Deleuze vit le
succès de ses propres cours (en termes d’affluence) comme une menace
d’enfermement dans un statut de « dinosaure » vincennois, voué à assurer
le rôle de « banque symbolique » au sein d’un département fortement
dépendant de la demande externe des autres départements.
[7] « Cinéma : une classification des signes du temps », cours du 2 novembre 1982 (partie 1).
Bruno Meziane
Bruno Meziane est doctorant en philosophie à l'université Paris 8, rattaché au Laboratoire des Logiques Contemporaines de la Philosophie (LLCP).